Dans les labos : «Le singe, c’est son boulot»
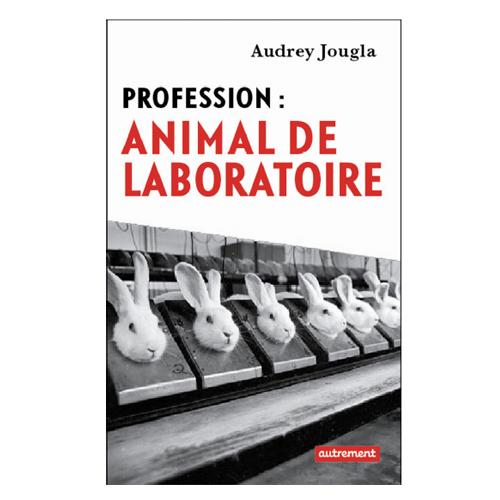
Elle savait juste que « ça existait ». Mais pas ce que cela signifiait vraiment. Nous allons « découvrir une histoire vraie. Une histoire qui a bouleversé [ses] certitudes et la vision [qu’elle avait] de l’existence ». Ce livre est le résultat d’une enquête effectuée « sous couverture », en prenant le prétexte d’un mémoire de recherche consacré à l’expérimentation animale comme « mal nécessaire ». Audrey Jougla l’a effectuée dans plusieurs laboratoires publics et privés, dans lesquels personne n’est jamais entré — pour que l’expérimentation animale ne reste pas une vague idée de ce que l’on s’en fait. Du courage, de l’abnégation, il lui en a fallu énormément — profonde admiration pour son travail. L’empathie et la compassion l’ont submergée, mais elle n’a pas eu « peur de s’abîmer », malgré la souffrance qu’elle a éprouvée devant des êtres sensibles totalement livrés à des expérimentateurs qui ne voient en eux qu’un quelconque « matériel de laboratoire ».
Médecine, chirurgie, produits chimiques, pharmaceutiques, prothèses, etc. On expérimente tout sur tout : singes, souris, chats, rats, chevaux, chiens, poissons… Aucun n’a eu le choix, celui d’être, ou non, un animal de laboratoire. Et pourtant, même s’il n’a pas décidé, accepté d’être cobaye, pour les scientifiques, cela ne fait aucun doute : « Le singe, c’est son boulot », dit l’un d’eux.
Ils sont des millions, en Europe (11,5 millions, dont 2,2 millions en France) et dans le monde, pour qui « c’est le boulot », un boulot qui consiste à subir des expériences douloureuses dans le silence des labos avant d’être éliminés, alors qu’il existe depuis longtemps des méthodes alternatives sans animaux. D’autant que, comme le répète l’association Antidote Europe, qui n’est pourtant pas une association de protection animale — et qui prône une médecine sans danger pour la santé humaine —, « aucune espèce biologique n’est fiable pour une autre ».
Pour toucher des subventions, les scientifiques doivent publier. Pour publier, ils doivent expérimenter. Parmi les innombrables expériences, celles induites par la recherche fondamentale. Le docteur vétérinaire André Ménache, directeur d’Antidote Europe, connaît bien le sujet :
« Selon sa définition, la recherche fondamentale est pratiquée principalement en vue d’acquérir de nouvelles connaissances, sans forcément envisager une application ou une utilisation particulière. […] Concernant la souffrance, il n’y a aucun doute que les animaux souffrent puis sont tués (pardon, sacrifiés), s’ils ne meurent pas au cours de l’expérience même. La souffrance animale est encadrée par la loi (la directive 2010/63/UE), qui définit un animal de laboratoire presque cyniquement comme “animal protégé” et une expérience comme une procédure ”susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables”. Sur le plan du coût-bénéfice, les choses sont encore plus scandaleuses, étant donné que la recherche fondamentale impliquant les animaux échappe aux contrôles scientifiques ou presque. Les quelques études approfondies réalisées dans ce domaine démontrent clairement que l’animal n’est pas un modèle propice pour trouver des traitements concernant la santé humaine. Il faut sans plus tarder changer de paradigme en se passant de l’illusion du modèle animal et adopter une recherche performante, pertinente pour l’homme et digne de ce XXIe siècle. »
La question que pose Audrey Jougla est simple mais essentielle : « Que l’on ait besoin ou pas d’une pratique donnée ne change pas le degré de moralité de cette dernière. […] Jusqu’à quel point la vie de certains êtres est-elle jugée sacrifiable pour le profit d’autres ? »
Quels sont les différents « jeux de rôles » dans les labos ?
Quand on évoque la maltraitance des animaux de laboratoire, on a tendance à mélanger plusieurs souffrances : celles qui sont liées directement aux expériences ; celles ensuite qui sont liées aux conditions de détention, carcérales, des animaux ; et celles enfin qui viennent de la relation entre les animaux et le personnel de laboratoire. C’est ce type de relation qui est très particulier, et parfois pervers : les animaliers, les chercheurs doivent en effet surmonter ce paradoxe, comment peut-on bien traiter celui à qui on va faire du mal ? Sans doute pour éviter la culpabilité inhérente aux expériences, on assiste à une séparation des rôles : certains vont seulement s’occuper des animaux au quotidien (les animaliers), quand d’autres ne les côtoient que pour les expériences (les chercheurs par exemple). Le « rôle du méchant » est parfois clairement identifié d’ailleurs par les animaux, comme les primates : ils savent très bien qui fait quoi, et qui vient pour les sortir de leur cage lors des expériences. Cette répartition des rôles permet à ceux qui expérimentent de ne pas s’attacher aux animaux et aux animaliers de se dire qu’ils ne leur font aucun mal. C’est en tout cas ce qui m’a été clairement dit.
Certaines expériences peuvent-elles être « orientées » ?
On comprend facilement qu’une espèce animale ne réagit pas de la même manière qu’une autre. Alors comment choisit-on les espèces pour les expériences ? C’est une question qu’on ne pose que rarement. On laisse ainsi supposer au grand public que la science est forcément objective, impartiale, experte, et neutre dans ses décisions. Or c’est très dangereux de croire que l’autorité du chercheur ne peut jamais être remise en question : d’abord parce que ça nous enlève le droit de penser et d’avoir une opinion sur un sujet scientifique, mais surtout parce que les faits prouvent d’eux-mêmes que certains résultats peuvent être complètement orientés. Cette question de biais induit dans les expériences par le choix d’une espèce ou d’une lignée de souris spécifique par exemple n’est pourtant pas un secret : l’étude [en 2012] de Gilles-Éric Séralini (les rats nourris au maïs OGM) l’a d’ailleurs exposée auprès des médias, à la plus grande surprise de certains. Il ne s’agit pas de dire que toutes les expériences sont « truquées », mais de porter un regard un peu plus critique sur la manière dont elles sont conduites. Les méthodes substitutives, elles, sont bien plus impartiales. Le Dr Reiss1 explique que certains produits seraient retirés du marché s’ils étaient testés avec celles-ci, et non avec des animaux dont la souche, ou l’espèce animale, modifie les résultats des protocoles.
1. Claude Reiss, biologiste moléculaire, ancien directeur de recherches au CNRS, est président d’Antidote Europe.
Des médicaments auxquels a été délivrée l’incontournable AMM (autorisation de mise sur le marché) peuvent se révéler dangereux pour les humains…
Lorsqu’un scandale pharmaceutique éclate, l’opinion publique reconnaît presque spontanément que les laboratoires sont liés à des intérêts financiers : il y a un consensus sur leurs intérêts commerciaux pouvant les pousser à agir à l’encontre de la santé humaine. Alors qu’à l’inverse, lorsqu’il s’agit d’expérimentation animale, les mêmes laboratoires sont considérés comme des entités presque philanthropiques, en qui l’on peut avoir une confiance aveugle. Subitement, tous les intérêts commerciaux disparaissent et l’opinion publique accepte la parole scientifique et doute de celle des militants. Alors que ce devrait être exactement l’inverse car les militants n’ont, eux, aucun intérêts financiers ou commerciaux derrière la cause qu’ils défendent. Cette différence de crédibilité n’est jamais dénoncée : pourquoi ?
En 2012, soit cinquante ans plus tard, Grünenthal, le fabricant de la thalidomide, a présenté ses excuses aux victimes de ce médicament testé avec succès sur les animaux, mais ayant des conséquences désastreuses sur l’homme. Il est loin d’être le seul. L’association One Voice explique que « de nombreux médicaments, considérés sans danger sur la base d’expérimentations pratiquées sur les animaux, ont eu des effets nocifs et même mortels chez l’être humain. Ils sont la preuve qu’il n’est pas possible de transposer avec fiabilité les résultats des expériences sur les animaux à l’être humain. Lipobay®, Vioxx®, Trasylol®, Acomplia® et TGN1412 ne sont que le sommet de l’iceberg. Rien qu’en Allemagne, on estime que pas moins de 58 000 décès sont le résultat des effets secondaires des médicaments1. » L’arrêt de la commercialisation par Novartis de la phénylbutazone (ou Butazolidine) pour l’homme en décembre 2011, à cause d’effets indésirables graves, est aussi lié à des tests sur les animaux qui étaient un succès. Le clioquinol a provoqué plus de mille morts, environ trente mille handicapés, aveugles ou paralysés.
Et, paradoxalement…
En effet, il n’y a pas que le problème des effets secondaires non décelés. On écarte aussi des substances toxiques sur les animaux qui pourraient être bénéfiques sur l’homme, comme le souligne le toxicologue Thomas Hartung. C’est le cas de l’aspirine : les doses auxquelles nous l’utilisons tuent 50 % des rats, donc elle ne serait pas commercialisée aujourd’hui. L’excès de précaution est donc redoutable. Il y aussi le retard pris dans la recherche car les expériences sur les animaux peuvent conduire vers des fausses pistes (ce fut le cas de la polio notamment), ou encore parce que la dangerosité d’une substance ou le lien entre facteur et maladie n’est pas prouvé par l’animal : le lien entre l’amiante et le cancer sur l’homme n’avait pas été confirmé par des études menées sur l’animal.
N’oublions jamais qui finance les expériences sur les animaux, que des médicaments inutiles ou dangereux sont commercialisés dans un seul but de profit par des industries, et que cette logique commerciale, qui n’a plus rien à voir avec le bien de l’humanité, coûte la vie à des millions d’animaux chaque année et leur occasionne d’atroces souffrances. Fin
Propos recueillis par Luce Lapin

